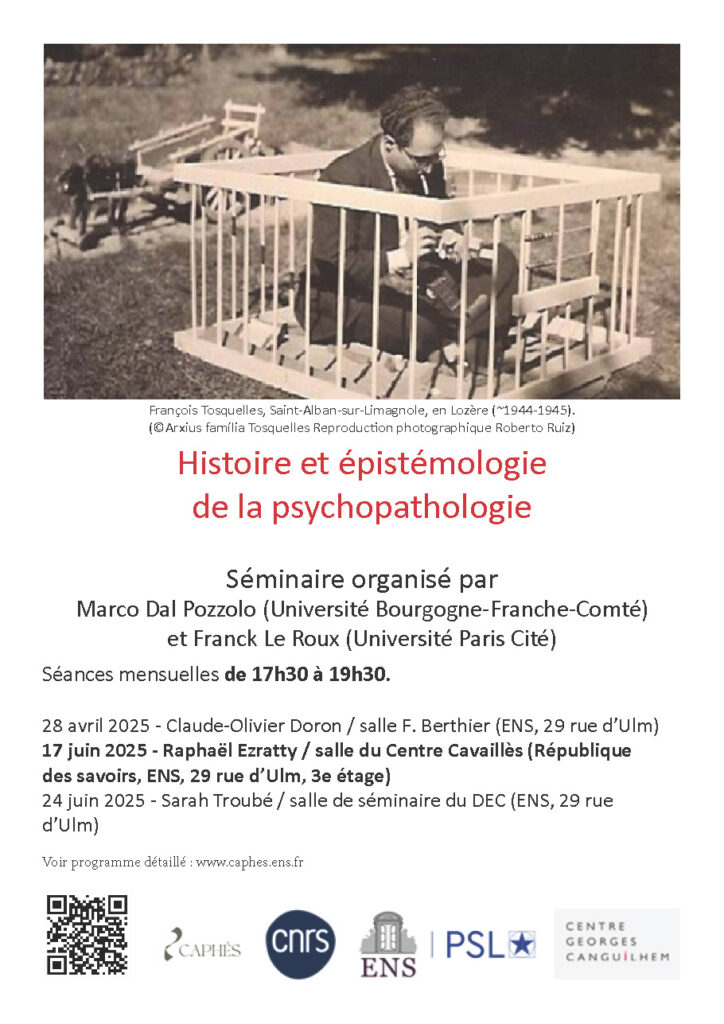Séminaire « Histoire et épistémologie de la psychopathologie », 17 juin 2025
Présentation générale du séminaire organisé par Marco Dal Pozzolo (Dr, Université Bourgogne-Europe, LIR3S) et Franck Le Roux (Dr, Université Paris Cité, CRPMS)
2° séance : 17 juin 2025, salle du Centre Cavaillès, (République des savoirs, ENS, 29 rue d’Ulm, 3e étage), 17h30
Raphaël Ezratty : Hikikomori : histoire et clinique d’un rétrécissement du milieu de vie
Résumé
Le hikikomori, retrait social extrême et prolongé observé initialement chez les jeunes Japonais, peut être lu comme un rétrécissement du milieu de vie — spatial, relationnel et existentiel. Il toucherait jusqu’à un million de personnes au Japon, principalement des hommes, mais a été constaté, à quelques différences près, dans bien d’autres pays, comme l’ont montré les travaux de synthèse d’auteurs tels qu’Alan Teo, Takahiro Kato, Yuichi Hattori, et bien d’autres.
En croisant psychiatrie clinique, biologie, histoire, sociologie et anthropologie, cette intervention montrera comment ce phénomène s’inscrit dans une niche écologique culturelle (I. Hacking) et peut être envisagé comme une maladie mentale transitoire, entre désaffiliation (R. Castel), modèles d’inconduite (R. Linton), désengagement social et stratégies lentes d’adaptation évolutive. Sur le plan développemental, elle mobilise l’analyse pionnière de l’« adolescence sans fin » (T. Saito), la théorie de l’attachement, la notion de moratorium (E. Erikson), et sa reprise dans la figure du moratorium ningen (« être humain en moratoire ») du psychiatre Okonogi Keigo. Elle tisse un parallèle entre les hikikomori (reclus), les NEETs japonais, britanniques ou européens, les jeunes hobos, et autres figures contemporaines du retrait volontaire ou de l’errance.
L’intervention s’ouvre également à des résonances issues de la culture populaire, de la littérature, de l’histoire religieuse et mystique, et de l’art expérimental. En faisant dialoguer les formes contemporaines du repli avec les figures classiques du retrait lettré et spirituel — à la manière des reclus taoïstes, des moines bouddhistes, des renonçants en Inde ou des fous de Dieu dans l’islam médiéval, elle proposera une lecture croisée des sous-cultures japonaises, américaines et européennes (D. Hebdige) pour interroger ce que ces retraits et errances disent du devenir adulte, du lien social et de la santé mentale dans les sociétés modernes, à la croisée du social et du psychologique.
Raphaël Ezratty, ancien élève de l’École normale supérieure, est titulaire d’un master en sciences des religions. Ancien chef de clinique de pédopsychiatrie à la Fondation Santé des Etudiants de France et à l’université Versailles Saint-Quentin, il est médecin psychiatre et pédopsychiatre. Il achève actuellement une thèse de doctorat en santé publique à l’université Paris-Saclay (EDSP), sous la direction de Bruno Falissard. Il a exercé la psychiatrie à Hong Kong, au Mexique et au Sénégal, et s’est spécialisé dans la clinique de l’adolescence et des jeunes adultes. Ses recherches actuelles portent sur l’anxiété dans les relations sociales, à la croisée de la psychologie, de l’anthropologie, des neurosciences et de la théorie de l’évolution, en lien avec des chercheurs au Canada, aux Etats-Unis et en Angleterre. En 2025, il a obtenu une bourse de la JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) pour poursuivre au Japon une étude comparative du phénomène hikikomori.